La fin de l'homme rouge.epub
Au fond, nous sommes des guerriers. Soit nous étions en guerre, soit nous nous préparions à la faire. Nous n’avons jamais vécu autrement. C’est de là que vient notre psychologie de militaires. Même en temps de paix, tout était comme à la guerre. On battait le tambour, on déployait le drapeau… Nos cœurs bondissaient dans nos poitrines… Les gens ne se rendaient pas compte de leur esclavage et même, ils l’aimaient, cet esclavage. Moi aussi, je m’en souviens : après la fin de l’école, toute notre classe avait l’intention d’aller défricher des terres vierges, nous méprisions ceux qui refusaient de le faire, nous regrettions, au point d’en pleurer, que la révolution, la guerre civile, tout cela ait eu lieu sans nous. Quand on regarde en arrière, on n’en revient pas : c’était vraiment nous ?
Mon père se rappelait que, pour sa part, il s’était mis à croire dans le communisme après le vol de Gagarine dans l’espace. Nous étions les premiers ! Nous pouvions tout ! Mon père n’est plus là.Il m’avait dit que pour eux, mourir à la guerre était plus facile que pour les jeunes gens peu aguerris qui se font aujourd’hui tuer en Tchétchénie. Dans les années 1940, ils sortaient d’un enfer pour entrer dans un autre.
Avant, le matin, on lisait la Pravda, et on savait tout. On comprenait tout.” Les gens anesthésiés par l’idée émergeaient lentement de leur léthargie. Si j’abordais le thème du repentir, on me répondait : “De quoi devrais-je me repentir ?” Chacun se sentait victime, mais pas complice. L’un disait : “Moi aussi, j’ai été en camp !”, un autre : “J’ai fait la guerre”, un troisième : “J’ai reconstruit ma ville en ruine, j’ai trimbalé des briques nuit et jour…” C’était totalement inattendu : ils étaient tous ivres de liberté, mais ils n’étaient pas préparés à la liberté. Où était-elle, cette liberté ?
Alors la voilà, cette liberté ! Nous attendions-nous à ce qu’elle soit comme ça ? Nous étions prêts à mourir pour nos idéaux. À nous battre pour eux. Mais c’est une vie “à la Tchékhov” qui a commencé. Sans histoire. Toutes les valeurs se sont effondrées, sauf celles de la vie. De la vie en général. Les nouveaux rêves, c’est de se construire une maison, de s’acheter une belle voiture, de planter des groseilliers… Il s’est avéré que la liberté était la réhabilitation de cet esprit petit-bourgeois que l’on avait l’habitude d’entendre dénigrer en Russie. La liberté de Sa Majesté la Consommation. L’immensité des ténèbres. Des ténèbres remplies d’une foule de désirs, d’instincts – d’une vie humaine secrète dont nous n’avions qu’une idée approximative. Nous avons passé toute notre histoire à survivre, et non à vivre. Désormais, l’expérience de la guerre ne servait plus à rien, il fallait l’oublier.
J’ai demandé à tous les gens que j’ai rencontrés : “C’est quoi, la liberté ?” Les parents et les enfants donnaient des réponses différentes. Ceux qui sont nés en URSS et ceux qui sont nés après l’URSS ne partagent pas la même expérience. Les parents : la liberté, c’est l’absence de peur, une personne qui choisit dans un magasin parmi une centaine de sortes de saucissons est plus libre que celle qui choisit parmi une dizaine. Les enfants :c’est quand on n’a pas peur de ses propres désirs, c’est posséder beaucoup d’argent, comme ça on a tout.
Un professeur d’université que je connais m’a raconté : “À la fin des années 1990, cela faisait rire les étudiants quand j’évoquais l’Union soviétique, ils étaient sûrs qu’un avenir nouveau s’ouvrait devant eux. Maintenant, ce n’est plus comme ça… Les étudiants d’aujourd’hui ont déjà appris ce qu’est le capitalisme, ils l’ont ressenti en profondeur – les inégalités, la pauvreté, la richesse arrogante. Ils ont sous leurs yeux la vie de leurs parents auxquels le pillage du pays n’a rien rapporté. Et ils ont des opinions radicales. Ils rêvent de faire leur révolution à eux. Ils portent des tee-shirts rouges avec des portraits de Lénine et de Che Guevara.”
Chez Dostoïevski, dans la “Légende du Grand Inquisiteur”, il y a une discussion sur la liberté. Sur le fait que le chemin vers la liberté est difficile, douloureux, tragique… “À quoi bon cette satanée connaissance du bien et du mal quand ça coûte aussi cher ?” L’homme doit tout le temps choisir : la liberté, ou la prospérité et une vie bien organisée, la liberté avec les souffrances, ou le bonheur sans liberté. Et la plupart des hommes prennent la seconde voie.
“L’homme resté libre n’a pas de préoccupation plus constante ni plus torturante que de trouver au plus vite quelqu’un devant qui s’incliner […] et à qui remettre ce don de la liberté avec lequel cette malheureuse créature vient au monde…”
… On a déjà parlé de ça… Depuis Staline jusqu’à Brejnev, tous les dirigeants qui se sont trouvés à la tête du pays avaient fait la guerre. Ils avaient vécu sous la Terreur. Leur psychologie s’était construite dans un contexte de violence. De peur perpétuelle. Et ils ne pouvaient pas non plus oublier l’année 1941… La retraite déshonorante de l’armée soviétique jusqu’à Moscou. Les soldats qu’on envoyait se battre en leur disant de se procurer une arme pendant la bataille. On ne comptait pas les hommes, mais on comptait les munitions. Il est normal… il est logique que des gens qui avaient cela gravé dans leur mémoire aient cru dur comme fer que, pour vaincre l’ennemi, il fallait fabriquer des tanks et des avions. Plus il y en avait, mieux c’était. Il y avait une telle accumulation d’armes dans le monde que l’URSS et l’Amérique auraient pu s’anéantir un bon millier de fois. Mais on continuait à en fabriquer. Et voilà qu’une nouvelle génération est arrivée. L’équipe de Gorbatchev, c’étaient tous des enfants de l’après-guerre… Eux, ils avaient la joie de la paix gravée dans leur conscience… Le maréchal Joukov au défilé de la Victoire sur son cheval blanc… C’était une autre génération… Et un autre monde. Les premiers se méfiaient de l’Occident, ils voyaient en lui un ennemi, et les seconds voulaient vivre comme les Occidentaux. Bien sûr que Gorbatchev faisait peur aux “anciens” ! Quand il parlait de bâtir un monde sans armes atomiques, on pouvait dire adieu à la doctrine de l’après-guerre, celle de “l’équilibre de la terreur”… Et quand il déclarait : “Dans une guerre atomique, il ne peut pas y avoir de vainqueur !”, cela voulait dire qu’on allait réduire l’industrie de la défense et les effectifs de l’armée. Nos magnifiques usines militaires allaient se mettre à fabriquer des casseroles et des presse-purées… C’était bien ça, non ? Il y a eu un moment où le haut commandement militaire s’est retrouvé presque en guerre contre les dirigeants politiques. Contre le secrétaire général. Ils ne pouvaient pas lui pardonner d’avoir perdu le bloc de l’Est, d’avoir quitté l’Europe la queue entre les jambes. Surtout la RDA. Même le chancelier Helmut Kohl a été surpris par l’extravagance de Gorbatchev : on nous avait proposé des sommes énormes pour quitter l’Europe, et il avait refusé. Ils étaient étonnés par sa naïveté. Par cette candeur russe. Il avait tellement envie qu’on l’aime… Que les hippies français portent des tee-shirts avec son portrait… Les intérêts du pays ont été bradés de façon stupide et honteuse. L’armée s’est retrouvée livrée à elle-même dans la forêt, dans la plaine russe. Les officiers et les soldats vivaient sous des tentes, dans des abris souterrains. La perestroïka… Cela ressemblait à la guerre… Et non à une renaissance…
Pour ce qui est du sang, des guerres et des révolutions, la Russie a atteint ses limites. Nous n’avons plus assez de force, ni d’une certaine forme de folie, pour recommencer. Les gens ont assez souffert comme ça. Maintenant, ils font leur marché : ils se choisissent des rideaux et des voilages, du papier peint, des poêles à frire, toutes sortes de choses. Ils aiment les couleurs vives. Parce qu’avant, chez nous, tout était gris et laid. On est comme des enfants, on est tout contents d’avoir une machine à laver le linge avec dix-sept programmes. Mes parents sont morts, maman depuis sept ans et papa depuis huit, mais je me sers toujours des réserves d’allumettes de maman, et il me reste encore de la semoule… Et du sel. Elle n’arrêtait pas d’acheter (à l’époque, on ne disait pas acheter, on disait “se procurer”), de faire des provisions pour les mauvais jours… Maintenant, on se promène dans les marchés et dans les magasins comme dans des musées, il y a de tout à profusion. On a envie de se dorloter un peu, de se faire plaisir. C’est une psychothérapie. Nous sommes tous des malades… (Elle réfléchit.) Vous vous rendez compte à quel point il fallait avoir souffert pour faire de telles réserves d’allumettes ! Je n’arrive pas à appeler cela de l’esprit bourgeois. Du consumérisme. C’est une façon de se soigner.
Les cuisines russes… Ces cuisines miteuses des immeubles des années 1960, neuf mètres carrés ou même douze (le grand luxe !), séparées des toilettes par une mince cloison. Un agencement typiquement soviétique. Devant la fenêtre, des oignons dans de vieux bocaux de mayonnaise, et un pot de fleurs avec un aloès contre le rhume. La cuisine, chez nous, ce n’est pas seulement l’endroit où on prépare la nourriture, c’est aussi un salon, une salle à manger, un cabinet de travail et une tribune. Un lieu où se déroulent des séances de psychothérapie de groupe. Au xixe siècle, la culture russe est née dans des propriétés d’aristocrates, et au xxe siècle, dans les cuisines. La perestroïka aussi. La génération des années 1960 est la génération des cuisines. Merci Khrouchtchev ! C’est à son époque que les gens ont quitté les appartements communautaires et ont commencé à avoir des cuisines privées, dans lesquelles on pouvait critiquer le pouvoir, et surtout, ne pas avoir peur, parce qu’on était entre soi. Des idées et des projets fantastiques naissaient dans ces cuisines ! On racontait des blagues… Il y avait toute une floraison d’histoires drôles… On captait la BBC. On parlait de tout : du fait que tout était merdique, du sens de la vie, du bonheur pour tous. Je me souviens d’un incident cocasse… Nous étions restés à bavarder très tard, il était plus de minuit, et ma fille de douze ans s’était endormie sur la banquette. Je ne sais plus pourquoi, en discutant, nous avons élevé la voix. Et elle s’est mise à crier dans son sommeil : “Mais arrêtez de parler politique ! Encore ce Sakharov… ce Soljénitsyne… ce Staline !” (Elle éclate de rire.)
On passait notre temps à boire du thé, du café, de la vodka. Dans les années 1970, c’était du rhum cubain. Tout le monde adorait Fidel Castro. La révolution cubaine. Le Che avec son béret. Une vraie vedette de Hollywood ! On n’arrêtait pas de papoter. Et puis la peur d’être sur écoute, c’était presque sûr… Au milieu d’une conversation, il y avait obligatoirement quelqu’un qui regardait le lustre ou l’interrupteur en rigolant. “Vous avez entendu, camarade général ?” Cette sensation de risque… C’était comme un jeu… On tirait même un certain plaisir de cette vie de mensonges. Une quantité infime de gens se rebellaient ouvertement, les autres étaient surtout des “dissidents de cuisine”. Ils faisaient des doigts d’honneur, mais au fond de leur poche.
Maintenant, on a honte d’être pauvre, de ne pas faire de sport… Bref, de ne pas réussir. Moi, je suis de la génération des balayeurs et des gardiens. C’était une forme d’émigration intérieure. On vivait sans remarquer ce qui nous entourait, c’était comme un paysage à la fenêtre. Ma femme et moi, nous sommes diplômés de la faculté de philosophie de l’université de Pétersbourg (à l’époque, c’était Leningrad), elle avait trouvé un travail de gardienne et moi de chauffagiste dans une chaufferie. On travaillait vingt-quatre heures d’affilée, et on passait deux jours à la maison. En ce temps-là, un ingénieur était payé cent trente roubles, et moi, dans ma chaufferie, j’en touchais quatre-vingt-dix. Autrement dit, on acceptait de perdre quarante roubles, mais en échange, c’était la liberté absolue. Nous lisions des livres, nous lisions énormément. Nous discutions. Nous pensions que nous produisions des idées. Nous rêvions d’une révolution, mais nous avions peur de ne pas vivre assez longtemps pour la voir. En somme, nous vivions repliés sur nous-mêmes, nous ne savions rien de ce qui se passait dans le monde. Nous étions des “plantes d’intérieur”. Tout ça, c’étaient des fantasmes, comme on s’en est rendu compte plus tard. Nous nous étions fait des idées sur tout : sur l’Occident, sur le capitalisme, sur le peuple russe. Nous vivions de mirages. La Russie des livres et des cuisines n’a jamais existé. Uniquement dans nos têtes.
Tout cela a pris fin avec la perestroïka… Le capitalisme nous est tombé dessus… Nous sommes sortis de nos cuisines pour descendre dans la rue, et là, nous avons compris que nous n’avions pas d’idées, que pendant tout ce temps, nous étions simplement restés assis à bavarder. Des gens complètement différents ont surgi d’on ne sait où, de jeunes gaillards en vestes rouges avec des bagues en or. Et de nouvelles règles du jeu : si tu as de l’argent, tu es quelqu’un, si tu n’en as pas, tu n’es personne. Qui ça intéresse, que tu aies lu tout Hegel ? “Un littéraire”, cela sonnait comme le diagnostic d’une maladie.
Avant, je repensais souvent à notre “vie de cuisine”. Ah, l’amour, en ce temps-là ! Et les femmes ! Ces femmes-là méprisaient les riches. On ne pouvait pas les acheter. Tandis que maintenant, personne n’a plus de temps pour les sentiments, tout le monde court après l’argent. La découverte de l’argent, cela a été comme l’explosion d’une bombe atomique…

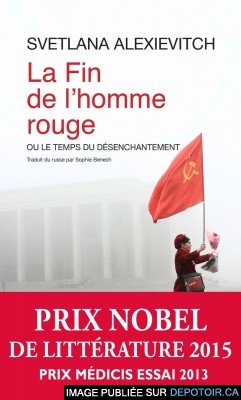

Commentaires recommandés
Aucun commentaire à afficher.
Un déchet à ajouter?
Il faudra cliquer là ou là.
Devenir éboueur
L'inscription est gratuite, rapide et presque pas humiliante.
Je suis prêt!Se connecter
Supposant bien sûr que vous ne soyez pas déjà banni.
Je veux revenir!